-
De même que le pictogramme peut se définir comme une version normée de la figure, on pourrait dire que l'idéogramme est une version systématisée du pictogramme. Ce qui lie ce signe au langage n'est plus de l'ordre de la métaphore ou du syncrétisme symbolique mais de l'alternative rationnelle.
Rationnel, ce signe l'est en premier lieu parce que sa conception graphique, même si elle demeure figurative, est ostensiblement dissociée de toute référence réaliste. Ce qui détermine formellement l'idéogramme est son calibrage, la règle spatiale qui lui attribue une place identique à celle des autres signes sur la surface d'un document. En Égypte, le hiéroglyphe se distingue de la figure parce que les dessins de dieu, d'oiseau ou de bouche à valeur idéographique s'inscrivent tous à l'intérieur d'un module unique.
Dans son rapport à la langue, l'idéogramme témoigne du même souci de mettre au service d'un système ce qui relève initialement dans la figure de la polysémie et de l'énigme. On observe que les trois civilisations de l'idéogramme ont adopté une solution identique : créer un signe qui, selon le contexte où il se trouve, peut assumer trois valeurs tout à fait différentes l'une de l'autre mais seulement trois : celle d'un mot (le logogramme), d'une syllabe dégagée phonétiquement de ce mot, que l'on utilisera pour désigner un mot homophone, une syllabe, voire, comme en Égypte, une seule consonne (le phonogramme) et celle de ce que l'on nomme selon les civilisations « clé » ou « déterminatif », c'est-à-dire l'idéogramme envisagé comme un indice de mot purement visuel, que l'on ne prononcera pas mais qui accompagnera graphiquement un phonogramme pour signaler son appartenance à telle ou telle catégorie (la clé de l'eau accompagnant les mots « source » ou « rivière », par exemple).
Cette tripartition autorise une extraordinaire souplesse d'usage. La valeur de « mot » de l'idéogramme peut être celle d'un mot précis, mais elle peut aussi correspondre et c'est le plus souvent le cas à un noyau sémantique à partir duquel se formuleront des mots différents selon le contexte. La valeur phonétique est tantôt rigoureuse comme elle l'a été en Mésopotamie, très tôt, dès que l'écriture sumérienne est devenue celle des Akkadiens, tantôt approximative comme en Chine, ou encore proliférante comme en Égypte, où l'on a multiplié les redondances phonétiques d'une manière qui nous paraît aberrante. Quant au déterminatif, relativement rare en Mésopotamie, devenu en Chine, au contraire, la base principale du système, puisque les « idéophonogrammes », signes doubles composés pour moitié d'une clé et pour l'autre d'un phonogramme, sont de loin les caractères les plus abondants de son vocabulaire écrit, il a suscité en Égypte une pratique à première vue surprenante. Par une sorte de retour du signe à son état initial de figure, le déterminatif peut se trouver situé en effet non pas dans la partie proprement textuelle d'un document mais dans sa partie iconique, le hiéroglyphe retrouvant alors les proportions exigées par l'image où on le déplace. Un tel transfert n'est pas exceptionnel : Pascal Vernus a dressé le répertoire des cas nombreux de glissements de fonctions des signes entre le texte et l'image que se sont autorisés les Égyptiens. Le phénomène se justifie surtout par deux traits caractéristiques de tout système idéographique quel qu'il soit, et dont l'écriture égyptienne ne fait que rendre les conséquences plus spectaculaires : le fait que le support de l'écrit joue un rôle déterminant c'est-à-dire, pour reprendre le vocabulaire des linguistes, pertinent à l'intérieur du système lui-même, et que le lecteur du message ne soit pas envisagé comme un simple déchiffreur mais comme participant activement, par un jeu d'observations et d'interprétations qui se situent à plusieurs niveaux, à l'existence même du texte. Les « textes » divinatoires mésopotamiens et chinois étaient fondés sur des principes identiques : le choix d'un support motivé, seul susceptible d'opérer la transmutation des traces et des empreintes en signes, et la collaboration étroite du devin à la constitution d'un message qu'il crée, en réalité, en le « lisant ». Ce sont ces principes que l'on retrouve à l'œuvre dans l'écriture proprement dite. Ils nous permettent de comprendre que les textes archaïques des deux civilisations aient une forme « télégraphique », l'information étant suggérée par un nombre de signes restreint, et, par conséquent, impossibles à énoncer de façon littérale (ce qui donnera naissance, en Chine, à une véritable « langue graphique », selon Léon Vandermeersch), ou que l'espace du cartouche primitif puis celui de la tablette d'argile et jusqu'à son format rond ou carré, voire son enveloppe conditionnent la compréhension des textes mésopotamiens (Jean-Marie Durand).
Ces principes éclairent enfin un dernier aspect de l'écriture prise à son état natif : le pouvoir que lui reconnaît la société. Ce pouvoir est très différent de celui dont on l'a investie plus tard en Occident en choisissant de limiter la définition de l'écriture à une fonction de conservation et de diffusion de la parole. En Chine ancienne, au contraire, l'écriture représente le pouvoir créateur par excellence, antérieur (avec la peinture dont on ne la dissocie pas) à celui de la parole. En Mésopotamie et en Égypte, les dieux de l'écriture sont toujours quant à eux des dieux intermédiaires, à la fois utiles et modestes : Inana, la déesse du grain, ou Nabû, un des dieux de la sagesse, Thot, le « maître des paroles divines ». Ce sont des conseillers, non des chefs. La figure du devin-lecteur leur a servi évidemment de modèle. Comme la détermination de l'écrit par son support a conduit à imaginer une forme de pouvoir curieusement labile, détourné, qu'illustre bien l'histoire de la reconstruction de Babylone par le roi Asarhaddon. La ville avait été détruite par son père, Sennachérib, et le dieu Marduk, dans son courroux, avait interdit qu'on la reconstruisît avant soixante-dix ans. Asarhaddon décida pourtant de n'en attendre que onze. Car la parole du dieu avait été inscrite sur une tablette, et le chiffre soixante-dix, lorsqu'on retournait cette tablette, se lisait onze. La liberté de l'écrit et, par suite, de sa lecture, faisait du pouvoir royal l'égal de celui des dieux.
Jean-Pierre BALPE, Anne-Marie CHRISTIN
Source : Logiciel Encyclopédia Universalis 2012
 votre commentaire
votre commentaire
-
L'écriture est apparue lorsque le système de signes visuels qui était censé transmettre les messages venus des dieux est devenu le support de ceux des hommes, c'est-à-dire des messages verbaux. Mais il ne pouvait s'agir que d'une traduction, ou plutôt d'une transposition : la composante iconique de l'écriture s'opposait à ce qu'elle fût une projection directe de la langue.
Le signe écrit ne s'identifie pas au signe verbal. Mais il doit encore moins être assimilé à une copie de la réalité. Contrairement à ce que l'on affirme généralement, en effet, le « pictogramme », ce signe figuratif que l'on trouve à l'origine de tous les systèmes écrits, et qui a été ensuite soit maintenu tel, comme en Égypte, soit rendu graphiquement méconnaissable comme en Mésopotamie ou en Chine, où il se combine aux signes abstraits issus de la divination, n'est pas une représentation de « chose ». En tant que figure, déjà, il ne saurait l'être. Ce que traduit une figure n'est pas de l'ordre du catalogage objectif mais de la pensée symbolique ; plus qu'un objet réel, une figure évoque l'importance de cet objet pour une société donnée (le soleil, la lune, la maison, le chat, etc.) et elle concentre dans son graphisme l'histoire d'un imaginaire culturel spécifique. Le pictogramme est un type de figure dont la fonction a été à la fois restreinte et modifiée : ce qu'elle doit susciter chez le spectateur n'est plus l'émergence nécessairement vague d'une notion polysémique, mais son équivalent verbal. Nommer un pictogramme ne saurait être nommer le réel : c'est apporter au schème visuel son complément dialectal, sorte d'hommage ambigu par lequel le groupe reconnaît ce qui lui échappe, mais aussi l'intègre à ses structures. Il n'est pas indifférent que ce soient des noms de personnes, et d'abord des noms de dieux, qui soient toujours largement majoritaires dans les lexiques pictographiques.
Lorsque ces noms de personnes sont des phrases, comme c'est le cas par exemple en Mésopotamie, on peut dire que l'écriture est prête à naître : la pensée de la syntaxe se combine désormais à celle du pictogramme. Mais une étape supplémentaire reste à franchir, celle où l'on passe de l'adéquation d'une figure donnée et de phrases connues d'avance à la création de phrases nouvelles. Cette liberté, elle est celle que suggéraient les pratiques divinatoires. Mais elle était interdite, alors, aux humains. L'idéogramme va la leur offrir.
Source : Logiciel Encyclopédia Universalis 2012
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, que Champollion réalisa en 1822 après des siècles d'essais infructueux, a bouleversé la conception que l'Occident se faisait jusqu'alors de l'écriture. Non seulement ces figures pittoresques que l'on interprétait par tradition comme des symboles ou des copies réalistes se révélaient être des signes, mais on leur découvrait aussi une faculté qui semblait depuis toujours réservée en propre à l'alphabet, la transcription phonétique des mots. Le dessin d'une bouche pouvait se lire « bouche », mais il notait également le son r, le dessin d'une chouette le m, celui d'une caille le w... Déterminante pour notre connaissance de la civilisation pharaonique, cette découverte l'était tout autant du point de vue d'une théorie générale de l'écriture. Car comment reconnaître encore au système alphabétique la supériorité dont on était convaincu qu'elle lui était due par principe, s'il s'avérait que d'autres, avant lui, avaient atteint le même niveau d'analyse sonore du langage ?
Jean-François Champollion (à gauche), natif de Figeac, parvint à l'âge de 32 ans à percer l'un des plus grand mystères pour les linguistes et les historiens de l'âge classique. Grâce à la fameuse "pierre de Rosette" (au centre) qui comprenait le même texte en trois langues différentes (hiéroglyphes égyptiens, démotique cursif et grec ancien), le jeune savant français déchiffra enfin le système hiéroglyphique. C'était le 14 septembre 1822. Il fit part de sa sensationnelle découverte dans un écrit resté célèbre : sa "Lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques" (à droite). source : http://www.u-p-r.fr
Il a pourtant fallu attendre encore plus d'un siècle pour que s'engage de façon sérieuse une remise en question du statut privilégié de l'alphabet dans l'ensemble des systèmes écrits. Champollion lui-même est, pour une part, responsable de ce retard. Car sa découverte, à vrai dire, reposait sur un malentendu. Elle concernait moins l'écriture en tant que telle que la langue qu'elle avait permis de véhiculer : sa Grammaire s'ouvre par un hommage à la philologie, science nouvelle, et science dominante, de son temps. Il était parvenu à lire les hiéroglyphes parce qu'il avait eu l'idée de comparer des textes rédigés en deux langues anciennes, égyptienne et grecque, avec la langue copte moderne que lui-même pratiquait. Mais c'est pour cette raison aussi qu'il avait pris à son compte sans songer à les discuter, car elles étaient sans incidences sur sa démarche, certaines des justifications que l'on apportait encore en Occident à l'aspect figuratif des hiéroglyphes. À l'origine, dit-il, reprenant les affirmations de Warburton un siècle plus tôt, les hiéroglyphes étaient « des imitations plus ou moins exactes d'objets existants dans la nature ». Le phonétisme de ces caractères n'avait donc pu se manifester qu'à une étape ultérieure de création, où l'on aurait réussi à obtenir ce que ces figures, apparemment vouées à ne transcrire que des vocables concrets, étaient dans l'incapacité de restituer : un état fidèle et complet de la parole.
Une interprétation aussi restrictive du rôle du visible dans l'écriture, dont une des conséquences fut, par exemple, que l'on décida en 1881 d'interdire aux sourds la langue des signes sous prétexte que « la parole vive, orale, encore plus que l'écriture, est le seul signe mental qui puisse indiquer les choses spirituelles et abstraites, sans leur donner une figure, sans les matérialiser », ne constitue pas un simple accident de notre histoire. La pensée de l'écriture comme mode visuel de transmission des messages linguistiques est profondément étrangère à l'Occident. Parce que notre civilisation, ainsi que l'a montré Jacques Derrida dans De la grammatologie (1967), est de type logocentrique. Mais également parce que l'écriture n'a jamais représenté pour nous autre chose qu'un héritage, et un héritage purement verbal. À la différence des Japonais, qui ont choisi sciemment de recourir aux idéogrammes chinois plutôt qu'à l'écriture indienne, nous n'utilisons l'alphabet que par hasard. Ce système était celui des Romains ; les textes fondateurs de la religion chrétienne avaient été traduits en latin et ils étaient conservés au moyen de son écriture : il semblait naturel d'y avoir accès par ce biais. On comprend qu'une écriture transmise de cette manière nous ait été, au sens littéral du terme, invisible : elle nous apparaissait aussi transparente à l'oral qu'il fût possible (et tel avait été en effet le souci majeur des Romains), sa fonction étant strictement de préserver à des fins pieuses les leçons canoniques d'un Verbe saint.
Ce n'est cependant pas le fait que nous ayons hérité de notre alphabet qui constitue une anomalie : c'est l'état d'ingénuité et de méconnaissance dans lequel cet héritage nous a trouvés. Il n'y a rien de plus normal, en effet, que d'emprunter une écriture : il n'existe aucun système dont on puisse dire qu'il ait été véritablement premier. Les Grecs ont inventé l'alphabet, mais cette invention prend appui sur le système phénicien, lequel était né, déjà, d'un remodelage du cunéiforme. Les systèmes idéographiques créés en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, aux environs de 3 000 ou 1 500 ans avant notre ère ne constituent pas davantage une origine. Ils résultent de la combinaison des deux modes de communication qui les avaient précédés : la parole et, apparue sans doute un peu plus tard, l'image. Ces deux médias correspondent chacun à des structures et à des usages différents de la communication sociale. La parole est l'exploitation par les membres d'une communauté d'un système de signes vocaux dont cette communauté est l'auteur. L'image est une proposition visuelle offerte à l'ensemble du groupe et qui combine deux données hétérogènes : une surface, prélevée artificiellement ou symboliquement sur le réel (une paroi rocheuse que l'on privilégie, mais aussi bien une portion du ciel, ou du sol), et des « figures », traces ou taches, produites ou non de main d'homme, réunies sur cette surface par un réseau d'« intervalles » qui leur permet de faire sens les unes avec les autres. L'image n'est pas un système, à la différence de la langue. Elle n'exige pas non plus la coprésence d'un émetteur et d'un récepteur : il lui suffit d'un observateur. Aussi sa fonction sociale est-elle autre que celle de la parole : elle sert à poser une relation entre les individus du groupe et un monde extérieur à ce groupe, où sa langue est ignorée ou sans pouvoir. La communication qu'elle promeut est essentiellement transgressive. La mythologie dogon nous renseigne sur la corrélation que les sociétés orales établissent entre parole et image. On y considère que « Dieu dessine », qu'il a créé l'univers en produisant des figures, mais que seule leur nomination par l'homme a pu leur donner vie.
L'apparition de la divination en Mésopotamie et en Chine constitue, comme l'ont montré Jean-Marie Durand et Léon Vandermeersch, l'étape immédiatement préliminaire à l'invention de l'écriture. Elle témoigne en effet d'une première forme de rationalisation de l'image, dans la mesure où la finalité vague qu'on lui avait attribuée d'abord permettre de communiquer avec les dieux est devenue beaucoup plus précise et contraignante. Le support élu par le devin concentre en lui certaines des valeurs symboliques essentielles à sa culture : carapaces de tortues en Chine, foies d'animaux en Mésopotamie. Les figures visibles sur ce support sont conçues comme formant système entre elles et elles sont désormais perçues comme des signes. Quant au devin, il n'a plus pour fonction, comme le mage, de manifester le pouvoir des dieux en agissant directement en leur nom sur des substances : son ministère consiste strictement à observer des ensembles de traces reconnus comme leurs messages et à tenter de les interpréter c'est-à-dire, en fait, de les lire. Telle est l'origine de l'écriture : l'invention de la lecture. Il est remarquable que la fonction du devin ait toujours été nettement distinguée de celle du prophète : le devin estime, suppute, il ne décide jamais. C'est au prophète de traduire verbalement ses hypothèses, et d'affirmer une éventuelle vérité.
Source : Logiciel Encyclopédia Universalis 2012
 votre commentaire
votre commentaire
-

Ceci doit-il tuer cela ? L'écran de l'ordinateur supplanter l'écrit ? Cette page immatérielle où l'on peut faire réapparaître à sa guise un texte ancien pour l'intégrer à un autre, tout à fait neuf, cette rédaction sur un clavier, et non plus au courant de la plume, et ce clavier lui-même qui, selon qu'on l'y invite, écrit, transforme ou crée de l'inédit, toutes ces « merveilles » nées de l'informatique ne doivent-elles pas rendre caduques les pratiques artisanales et millénaires du papier, de l'encre, voire de l'imprimé ?
Deux mondes semblent s'opposer, à l'heure actuelle, à l'intérieur de l'univers de la communication graphique-visuelle. Mais ne s'agit-il pas, en fait, d'une opposition illusoire ? N'est-ce pas, au contraire de ce que l'on suppose, un retour au passé extrême de l'écrit, à ses sources idéographiques, que nous offre l'ordinateur ? Plus que l'écrit, à la vérité, c'est l'alphabet et ses contraintes, auxquelles nous nous sommes habitués comme si elles étaient inévitables, que l'ordinateur met en question et cela, au profit de l'écriture même.
Source : Logiciel Encyclopédia Universalis 2012
 votre commentaire
votre commentaire
-
- Les pays nordiques
Depuis la fin des années 1960, le roman policier à contenu social s'est développé dans de nombreux pays. En Suède, dès 1965, le couple formé par Maj Sjöwall et Per Wahlöö se livrait à une violente critique du « paradis suédois » avec une série de dix enquêtes menées par l'inspecteur Martin Beck et ses hommes. Ce changement radical au cœur d'une littérature policière jusque-là assez classique a généré, non seulement en Suède mais dans pratiquement tous les pays nordiques, plusieurs générations d'écrivains qui s'expriment de façon critique sur la société. Dans un registre proche du couple Sjöwall-Wahlöö qui l'a inspiré, on trouve Mankell (Meurtriers sans visage) dont la série qui a pour héros l'inspecteur Kurt Wallander obtient un grand succès en France, ce qui incite les éditeurs à accorder une place importante aux auteurs suédois. Parmi ceux qui sont traduits, Kjell-Olof Bornemark (1924-2006) débute avec un récit d'espionnage atypique (La Roulette suédoise, 1982), puis il met en scène un laissé-pour-compte que son exclusion de la société va conduire à un geste fatal (Coupable sans faute, 1989). Staffan Westerlund entame avec L'Institut de recherches (1983) une série consacrée à Inga-Lisa, une avocate spécialisée dans la défense de l'environnement. Le criminologue G. W. Persson, conseiller auprès du ministre de la Justice, donne une trilogie sur « le crime et le châtiment en Suède » (1978-1982) avec comme protagoniste le policier Lars Martin Johansson, qui n'hésite pas à dévoiler les manipulations politico-financières et les corruptions de fonctionnaires. On retrouve Johansson vingt ans plus tard dans La Nuit du 28 février (2002) qui évoque l'assassinat jamais élucidé du Premier ministre Olof Palme en 1986. Ni ce dernier ni aucun des autres acteurs de ce drame n'est nommé. Mais, usant du roman à clé, l'auteur démontre comment l'incurie combinée du gouvernement, de la police et des services secrets a rendu possible ce meurtre et impossible sa résolution. Parmi les récents romanciers suédois, citons Ake Edwardson, créateur d'une série avec le commissaire Erik Winter de Göteborg, Liza Marklund qui, après avoir été grand reporter à la télévision, met en scène la journaliste Annika Bengtzon qui mène des enquêtes dangereuses (Studio Sex), tandis que sa consœur Karin Alvtegen (petite nièce d'Astrid Lindgren, la créatrice de Fifi Brindacier) s'est fait connaître avec un thriller psychologique fort réussi (Recherchée).

La juriste Asa Larsson donne un beau portrait d'une avocate, Rebecka Martinsson, confrontée à une secte messianique lorsqu'elle retourne dans le village lapon de son enfance (Horreur boréale). Issue du courant appartenant au roman prolétarien, Aino Trosell s'est orientée à partir de 1999 vers le roman policier tout en continuant à jeter un regard critique sur la société suédoise, comme le démontre Si le cœur bat encore (1998). Il s'agit du premier volet d'une trilogie, dont la protagoniste, Siv Bahlin, est aide-soignante dans une maison de retraite. Mais la trilogie qui a fait le plus parler d'elle a pour titre Millenium et pour auteur Stieg Larsson (1954-2004), mort prématurément peu après avoir achevé son manuscrit. Ces trois récits ont pour personnages centraux le journaliste Mikael Blomkvist et la sauvage Lisbeth Salander, placée sous tutelle, confrontés à de dangereux personnages. Une saga haletante et un succès public indéniable.

Aux Pays-Bas, Janwillem Van de Wetering recrée l'atmosphère d'un commissariat d'Amsterdam proche de celui d'Ed McBain, au moins à ses débuts. Car ces policiers bataves, adeptes de la pensée orientale, sont les plus zen du genre.
En Finlande, une passionnante série de Matti Yrjänä Joensuu nous plonge au cœur de la délinquance. L'action se déroule à Helsinki, avec l'inspecteur Timo Harjunpää (Harjunpää et le fils du policier). De son côté, Leena Lehtolainen publie les enquêtes de Maria Kallio (Mon Premier Meurtre), une femme policier très populaire chez les lecteurs finlandais.
Chez les Danois, Leif Davidsen (La Femme de Bratislava) s'est rendu célèbre par ses plongées dans l'histoire qu'il ausculte à la manière d'un Didier Daeninckx. On doit lire également Flemming Jarlskov (Coupe au carré), Peter Hoeg (Smilla et l'amour de la neige) et Dan Turell, dont le détective privé lorgne du côté de Hammett (Mortel Lundi), alors que celui du Norvégien Gunnar Staalesen (Le Loup dans la bergerie) fait plutôt penser au Philip Marlowe de Chandler. En parallèle à cette passionnante série, Staalesen a écrit la saga de sa ville natale (Le Roman de Bergen, six volumes), tandis que Jo Nesbo est en tête des ventes avec L'Étoile du diable, ce signe qu'un tueur en série laisse auprès de ses victimes (il leur coupe un doigt). Parmi les autres auteurs norvégiens, citons Ann Holt (La Déesse aveugle), Karin Fossum (Celui qui a peur du loup), Morten Harry Olsen (Tiré au sort), Fredrik Skagen (Black-Out), Kim Smage (Sub Rosa) et Pernille Rygg (L'Effet papillon).
La surprise vient d'Islande. Ce pays de 350 000 habitants compte déjà quatre auteurs traduits à l'étranger : Olafur Haukur Simonarson (Le Cadavre dans la voiture rouge), Arni Thorarinsson (Le Temps de la sorcière), Olafur Johan Olafsson (Absolution) et le plus populaire à ce jour, Arnadur Indridason. Les enquêtes de son commissaire Erlandur dans La Cité des jarres, puis dans La Femme en vert et enfin dans La Voix lui ont valu un succès international.
- Allemagne et Autriche
L'école allemande est florissante avec Horst Bozetsky, Hansjorg Martin, Jürgen Alberts, Frank Goyke, Pieke Bierman, Jacob Arjouni ou Bernhard Schlink. Affaires criminelles, racisme, déviances, scandales : leurs romans passent au crible l'histoire de l'Allemagne réunifiée. Citons encore Ingrid Noll et ses sombres intrigues familiales (Confession d'une pharmacienne) et Christian V. Ditfurth dont le protagoniste, un historien de Hambourg, le Pr Stachekmann, est confronté à la Stasi, quatorze ans après la chute du Mur de Berlin et la disparition de la R.D.A. (Frappé d'aveuglement). Un thème qu'on retrouve dans Welcome OSSI de Wolfgang Brenner. En Autriche, le plus brillant romancier est sans conteste Wolf Haas, créateur du détective privé Simon Brenner, bourru, totalement dépourvu de méthode et de flair. Ses enquêtes sont jubilatoires, en particulier Silentium, où il est confronté à des pratiques pédophiles dans un établissement scolaire dirigé par des religieux

- Italie
Après les années noires où la littérature policière avait été interdite par Mussolini, Giorgio Scerbanenco (1911-1969) fait figure de pionnier. Considéré comme le père du roman noir italien, il met en scène Duca Lamberti, radié du conseil de l'ordre des médecins pour euthanasie, et n'a pas son pareil pour décrire le banditisme organisé et les affaires louches à Milan (Vénus privée, 1966).
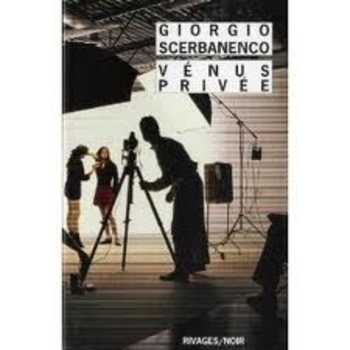
À la même époque, on peut également citer le duo formé par Carlo Fruttero et Franco Lucentini (La Femme du dimanche, 1972), et Leonardo Sciascia, grand pourfendeur de la Mafia dont le roman Le Contexte (1971) a inspiré le film Cadavres exquis (1975) de Francesco Rosi. Un des vieux amis de Sciascia, tard venu à l'écriture, Andrea Camilleri, a su séduire le public européen avec son commissaire Montalbano qui évolue en Sicile, région natale de son créateur. Aujourd'hui, l'Italie compte des dizaines d'auteurs. Parmi les plus talentueux, citons Pino Cacucci (San Isidro football club), Carlo Lucarelli (Guernica), Augusto De Angelis (L'Hôtel des trois roses), Laura Grimaldi (Le Soupçon), Santo Piazzese (Le Souffle de l'avalanche), Andrea Pinketts (Le Sens de la formule), Franco Mimmi (Notre Agent en Judée), Margherita Oggero (La Collègue tatouée), Renato Olivieri (L'Affaire Kodra), Marcello Fois (Plutôt mourir), Sandrone Dazieri (Le Blues de Sandrone), Giorgio Todde (L'État des âmes), Piergiorgio di Cara (Île noire), Bruno Arpaia (Dernière Frontière), Nicoletta Vallorani (La Fiancée de Zorro), Nino Filasto (La Fiancée égyptienne), Giancarlo Carofiglio (Témoin involontaire)... Trois chefs-d'œuvre : Macaroni (1997) de Loriano Macchiavelli et Francesco Guccini, évoque l'immigration italienne en France et imbrique de façon parfaite énigme, suspense et constat social. L'Immense Obscurité de la mort (2004) de Massimo Carlotto, où un prisonnier qui a tué lors d'un braquage une femme et son fils, formule quinze ans plus tard un recours en grâce. Il sollicite le pardon du mari et père des victimes : en résulte un tragique face à face, à l'épilogue déroutant. Romanzo criminale (2002), de Giancarlo de Cataldo, juge à la cour d'assises de Rome, est la chronique magistrale du monde du crime à Rome de 1978 à 1992. Enfin signalons deux auteurs singuliers : Gilda Piersanti auteur de plusieurs polars romains (Vert palatino) habite Paris depuis trente ans ; Cesare Battisti, ancien membre d'un groupe armé exilé en France, en fuite pour échapper à l'extradition depuis 2004, arrêté et emprisonné au Brésil en 2007, a signé une dizaine de romans noirs dans lesquels il dénonce la lutte armée qui se retourne toujours contre ses auteurs.
- Espagne et Andorre
Peu avant la fin de la dictature franquiste, Jaume Fuster (1945-1998) publie Petit à petit l'oiseau fait son nid (1972), un roman noir qui illustre la liaison entre la bourgeoisie barcelonaise et la pègre des bas-fonds. Manuel Vazquez Montalbán (1939-2003), « le Chandler catalan », prend le relais pour relancer le genre avec Pepe Carvalho, son détective épicurien. Francisco Gonzales Ledesma, après avoir publié plus de 500 pulps sous le pseudonyme de Silver Kane, passe au roman. Certains s'apparentent à une chronique des années de la dictature (Los Napoleones), d'autres appartiennent à la série consacrée à Ricardo Méndez, un commissaire de Barcelone, nostalgique et plein de compassion pour les faibles (La Dame de Cachemire). Si Juan Madrid (Cadeau de la maison) et Andreu Martin (Prothèse) s'impliquent à leurs débuts dans des récits âpres et violents, Arturo Pérez-Reverte préfère choisir une voie plus intellectuelle et ludique (Le Tableau du maître flamand).
Barcelone abrite de nombreux écrivains. Outre Fuster, Vazquez Montalbán, Gonzales Ledesma et Andreu Martín, dont les exploits du jeune détective Flanagan sont traduits dans toute l'Europe, on peut citer l'Argentin Raúl Argemí (Les morts perdent toujours leurs chaussures) qui traite de sujets politiques avec une folie baroque et un humour grinçant ; Eduardo Mendoza, ancien interprète à l'O.N.U., et son univers souvent burlesque (Le Labyrinthe aux olives) ; les féministes Alicia Gimenez Bartlett avec son désopilant tandem de policiers Petra Delicado et Fermín Garzon (Le Jour des chiens) et Maria Antonia Oliver (Antipodes), créatrice d'Apolonia Guiu, détective privée barcelonaise ; Xavier Moret qui met en scène un écrivain raté (Qui tient l'oseille tient le manche).
Signalons également l'œuvre importante de Mariano Sanchez Soler (Oasis pour l'O.A.S.), auteur de plusieurs romans noirs qui ont pour protagonistes les inspecteurs Pulido et Galeote, ainsi que d'essais divers sur le fascisme, la corruption et la famille Franco.

Il a aussi fait connaître sa ville natale d'Alicante en y organisant plusieurs manifestations littéraires autour du roman noir.
Le Pays basque compte au moins deux auteurs de qualité : Juan Bas (Scorpions pressés) et José Javier Abasolo (Nul n'est innocent). La violence qui parfois s'exprime dans cette province a inspiré à Juan Antonio de Blas, L'Arbre de Guernica, dans lequel son humour acide et son goût pour la dérision n'épargnent personne. Citons encore Juan Marse (Boulevard du Guinardo), Lorenzo Silva (La Femme suspendue), Suso de Toro (Land Rover) et concluons par l'académicien Antonio Muñoz Molina qui n'a pas hésité à écrire Pleine Lune, un roman de genre parfaitement réussi.
Même la principauté d'Andorre est touchée par l'épidémie du « noir », avec Albert Salvado (Le Rapt, le mort et le marseillais) et Albert Villaro (Chasse à l'ombre).
- Encore l'Europe
Le développement de la littérature policière est un mouvement inéluctable qui touche chaque pays car son lectorat est de plus en plus vaste. Mais les ouvrages disponibles en France ne reflètent qu'imparfaitement cette évolution, dans la mesure où la majeure partie des traductions provient de pays anglo-saxons. Signalons toutefois que le roman policier et/ou noir a atteint l'Albanie avec Virion Graçi (Le Paradis des fous), Fatos Kongoli (Tirana Blues) et le vétéran Ismaël Kadaré, auteur de Qui a ramené Doruntine ? et Le Dossier H. On trouve également des œuvres intéressantes en Bulgarie avec Emilia Dvorianova (Passion, ou la Mort d'Alissa), en Grèce avec Sèrgios Gàkas (La Piste de Salonique) et Petros Markaris (Le Che s'est suicidé), au Portugal avec José Cardoso Pires (Ballade de la plage aux chiens) et l'excellent Francisco José Viegas (Un ciel trop bleu). La Russie se signale avec la prolifique Alexandra Marinina (Ne gênez pas le bourreau), Paulina Dachkova (Les Pas légers de la folie), Julian Semionov (Petrovka 38), Arkadi et Gueorgui Vaïner (L'Évangile du bourreau), et la Turquie avec trois romancières : Esmahan Aykol (Meurtre à l'hôtel du Bosphore), Mine Kirikkanat (La Malédiction de Constantin), Mehmet Murat Somer (On a tué Bisou !), sans oublier Celil Oker, créateur d'un détective privé turc dont les six enquêtes restent inédites en France. Signe des temps, en avril 2008, la Série noire a publié Les Fantômes de Breslau, du Polonais Marek Krajewski.
- Amérique du Sud
En Amérique latine aussi, le roman noir se porte bien, au Mexique notamment avec Paco Ignacio Taibo II (À quatre mains), Juan Hernández Luna (Naufrage), Sergio González Rodríguez (Des os dans le désert), Eduardo Monteverde (Alvaro dans ses brumes), Joaquín Guerrero-Casasola, lauréat du prix 2007 de L'H Confidencial (bibliothèque policière de Barcelone) avec Ley Garrote, histoire d'un privé mexicain à la recherche d'une fille de bonne famille kidnappée. N'oublions pas Guillermo Arriaga, scénariste de plusieurs films remarquables (Amours chiennes ; 21 grammes ; Trois Enterrements) et auteur entre autres de L'Escadron guillotine (1994) et Le Bison de la nuit (2000).
Le roman noir a également suscité des œuvres passionnantes à Cuba avec Daniel Chavarria (Un thé en Amazonie), Justo Vasco (1943-2006 ; L'Œil aux aguets), Lorenzo Lunar (La Boue et la mort), Amir Valle (Jineteras), José Latour (Nos Amis de La Havane) et surtout Leonardo Padura Fuentes (Les Brumes du passé), au Brésil avec Rubem Fonseca (Du grand art), Aguinaldo Silva (L'Homme qui acheta Rio) et Patricia Melo (O Matador), au Chili avec Luis Sepúlveda (Un nom de torero), Ramon Díaz Eterovic (La mort se lève tôt) et Roberto Ampuero (Le Rêveur de l'Atacama), en Colombie avec Santiago Gamboa (Les Captifs du lys blanc) et plus encore en Argentine où, après Osvaldo Soriano (Je ne vous dis pas adieu), sont apparus Rolo Diez (Le Pas du tigre), Enrique Medina (Les Chiens de la nuit), Juan Sasturain (Manuel des perdants), Sergio Sinay (Le Tango du mal aimé), Mempo Giardinelli (Les morts sont seuls), Juan Jose Saer (L'Enquête). Outre sa diversité, la caractéristique de cette mouvance est d'avoir renouvelé le genre en lui faisant subir un traitement original dans chaque pays. Pour faire toucher du doigt les réalités sociales sud-américaines, tous ces merveilleux conteurs usent de la critique avec humour et dérision. Chacun a son style et pratique des constructions savantes. Certains se livrent au métissage et empruntent à d'autres types de récits (aventure, espionnage, politique-fiction, etc.). Bref, partout imagination et fantaisie règnent en maître. Ce courant n'a pas fini de surprendre le lecteur.
Source : Logiciel Encyclopédia Universalis 2012
 votre commentaire
votre commentaire
La passion du livre ...











